27 Avr Évolution des taux de cancers à travers l’histoire et le monde
Introduction
Le cancer est aujourd’hui l’une des principales causes de mortalité dans le monde, avec près de 10 millions de décès en 2020 (soit presque un décès sur six) who.int. De plus, l’incidence du cancer (le nombre de nouveaux cas) a fortement augmenté au fil des siècles. On estime par exemple qu’en 2020 il y a eu environ 19,3 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, contre seulement 10 millions de cas en l’an 2000 who.int pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Ce chiffre pourrait atteindre 28 millions de nouveaux cas annuels vers 2040 du fait de l’accroissement et du vieillissement des populations pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Cette augmentation s’explique par une combinaison de facteurs démographiques, de changements sociétaux (industrialisation, modes de vie) et d’évolutions médicales (meilleure détection, progrès du diagnostic), ainsi que par de véritables hausses de certains facteurs de risque (tabagisme, pollution, etc.).
Ce rapport propose une étude de l’évolution des taux de cancers à travers toutes les époques connues et dans les différentes régions du globe, et analyse les causes principales de l’augmentation observée. Nous présenterons d’abord un historique de l’incidence du cancer, puis une comparaison géographique par pays et continents. Ensuite, nous détaillerons les principales causes identifiées de l’augmentation des cancers, avant d’examiner l’impact du progrès médical et du dépistage sur ces tendances. Enfin, une synthèse récapitulera les points clés et ouvrira la discussion sur les perspectives de contrôle du cancer.
Évolution historique des taux de cancers
Antiquité et époques pré-industrielles : Le cancer est connu depuis l’Antiquité – des tumeurs osseuses ont été identifiées sur des momies égyptiennes, et un papyrus d’environ 1600 av. J.-C. décrit des cas de tumeurs du sein edu.rsc.org. Cependant, avant l’époque moderne, les cancers semblaient relativement rares, en grande partie parce que peu de personnes vivaient jusqu’à un âge avancé où le cancer devient fréquent, et parce que les capacités de diagnostic étaient très limitées. Au milieu du XIX^e siècle par exemple, on estime qu’en Angleterre et au Pays de Galles le cancer ne représentait qu’environ 1,7 % des causes de décès enregistrées pmc.ncbi.nlm.nih.gov. De même, des analyses paléopathologiques suggèrent qu’avant la révolution industrielle, la proportion de la population atteinte d’un cancer était bien plus faible qu’aujourd’hui. En Grande-Bretagne médiévale, seulement ~1 % des individus étaient initialement supposés souffrir d’un cancer d’après les traces visibles sur les squelettes. Des recherches récentes utilisant des outils de détection modernes ont réévalué cette incidence médiévale entre 9 % et 14 % – soit dix fois plus que l’estimation précédente nationalgeographic.fr. Cela reste nettement inférieur au risque actuel observé dans les pays occidentaux : de nos jours, plus de la moitié des Britanniques développeront un cancer au cours de leur vie nationalgeographic.fr. Cette différence s’explique par l’absence, autrefois, de nombreux facteurs de risque modernes et par la mortalité précoce due aux maladies infectieuses ou aux accidents, qui empêchait souvent les gens d’atteindre l’âge où surviennent la plupart des cancers.
Transition aux XIX^e–XX^e siècles : À partir du XVIII^e siècle, avec les débuts de l’industrialisation, l’espérance de vie commence à augmenter en Occident grâce aux progrès de l’hygiène et de la médecine. De plus en plus de personnes atteignent un âge avancé, ce qui permet mécaniquement à davantage de cancers de se manifester. Parallèlement, l’industrialisation introduit de nouvelles expositions aux agents cancérogènes. Un exemple marquant est celui des ramoneurs de Londres : en 1775, le médecin anglais Percivall Pott observa une fréquence anormale de cancers du scrotum chez ces jeunes ramoneurs, et attribua ce cancer à l’exposition aux résidus de suie embryo.asu.edu. Ce fut le premier cancer d’origine professionnelle documenté, soulignant déjà le rôle de l’environnement et des produits chimiques issus de l’industrie dans l’étiologie de certains cancers. Durant le XIX^e siècle, à mesure que les maladies infectieuses reculaient, la part des maladies chroniques (dont les cancers) augmenta fortement. Ainsi, en Grande-Bretagne, la mortalité par cancers a grimpé régulièrement avec la révolution industrielle : en Écosse, le taux de mortalité par cancer est passé d’environ 70 pour 100 000 habitants vers 1890 à plus de 250 pour 100 000 vers 1980 pmc.ncbi.nlm.nih.gov. De même, en Angleterre et au Pays de Galles, les maladies non transmissibles (cancers, maladies cardiovasculaires, etc.) représentaient à peine 44,8 % des décès en 1850, mais 56,1 % en 1900 et plus de 76 % à la veille de la Seconde Guerre mondiale pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Cette transition épidémiologique – où les maladies chroniques ont remplacé les maladies infectieuses comme principales causes de décès – s’est produite d’abord en Europe occidentale et en Amérique du Nord au début du XX^e siècle, puis s’est étendue progressivement au reste du monde au cours du XX^e siècle ncbi.nlm.nih.gov.
Explosion au XX^e siècle et facteurs de risque modernes : Après la Seconde Guerre mondiale, l’incidence des cancers a continué d’augmenter dans le monde entier, mais à des rythmes variables selon les pays. Une grande partie de l’augmentation globale s’explique par la croissance démographique et l’allongement de la durée de vie. Par exemple, aux États-Unis, la population est passée de 120 millions à 300 millions d’habitants entre 1930 et 2006, tandis que l’espérance de vie moyenne montait de 57 à 76 ans medecinesciences.org. À population et structure d’âge constantes, l’augmentation de l’incidence est beaucoup plus modérée. En effet, lorsque l’on corrige statistiquement l’incidence du cancer pour éliminer l’effet du vieillissement, on constate qu’aux USA l’incidence globale (tous cancers confondus) est restée relativement stable entre 1975 et 2013 medecinesciences.org. On observe même, dans ces pays, un récent fléchissement de certains cancers grâce aux mesures de prévention. Par exemple, l’incidence du cancer du poumon chez l’homme, après avoir fortement augmenté au milieu du XX^e siècle sous l’effet du tabagisme de masse, a entamé une décroissance nette à partir des années 1980 medecinesciences.org (suivie d’une baisse de la mortalité quelques années plus tard), du fait de la diminution du tabagisme à partir des années 1960 medecinesciences.org. De même, l’incidence du cancer de l’estomac a chuté tout au long du XX^e siècle dans les pays développés, avec l’amélioration de la conservation des aliments et la baisse des infections à Helicobacter pylori news.cancerresearchuk.org. Ces tendances montrent que l’“explosion” des cancers au XX^e siècle n’est pas uniquement due à une vague mystérieuse de cancer, mais largement à des changements de société : plus de personnes à risque (population plus nombreuse et plus âgée), meilleure détection des cancers, et exposition accrue à certains facteurs de risque (comme le tabac, dont l’usage s’est généralisé dans la première moitié du XX^e siècle).
Néanmoins, certains types de cancers ont connu de véritables hausses d’incidence indépendantes du vieillissement. Par exemple, le cancer du poumon (surtout chez l’homme) a connu une véritable épidémie dans la deuxième moitié du XX^e siècle en raison du tabagisme massif – ce cancer est ainsi devenu l’un des plus meurtriers vers 1980-1990 medecinesciences.org. De même, les cancers de la peau (mélanomes) ont vu leur incidence augmenter dans la fin du XX^e siècle avec la popularité des expositions solaires intenses et des cabines de bronzage news.cancerresearchuk.org. En parallèle, l’instauration de programmes de dépistage à grande échelle pour certains cancers à partir des années 1980-1990 (mammographie pour le cancer du sein, dosage PSA pour le cancer de la prostate, etc.) a entraîné une augmentation apparente du nombre de cas diagnostiqués, en détectant des cancers qui autrefois seraient restés ignorés (nous y reviendrons) news.cancerresearchuk.org.
Situation actuelle et XXI^e siècle : Aujourd’hui, le cancer s’impose comme un problème de santé majeur à l’échelle mondiale. Dans de nombreux pays développés, il rivalise avec les maladies cardiovasculaires pour la première place des causes de décès. Par exemple, en France le cancer est devenu la première cause de mortalité avec 157 400 décès en 2018, devant les maladies cardiovasculaires reseau-environnement-sante.fr. Globalement, les dernières estimations disponibles (2020-2022) indiquent environ 19 à 20 millions de nouveaux cas de cancers par an dans le monde, pour environ 10 millions de décès annuels pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Ce fardeau du cancer a doublé en 20 ans (il était d’environ 10 millions de cas et 6 millions de décès en l’an 2000) who.int, et les projections démographiques suggèrent une poursuite de cette hausse. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) anticipe plus de 30 millions de nouveaux cas annuels vers le milieu du XXI^e siècle si les tendances actuelles se maintiennent cancerresearchuk.org. L’augmentation du nombre absolu de cas s’observe presque partout, même si dans certains pays riches le taux d’incidence ajusté sur l’âge stagne ou baisse légèrement pour certaines localisations. En résumé, du fait de l’allongement de la vie humaine et de la diffusion mondiale des modes de vie industriels, le cancer est passé en quelques siècles d’un mal relativement rare (quelques pourcents des décès au XIX^e siècle) à l’une des premières causes de décès de l’humanité au XXI^e siècle pmc.ncbi.nlm.nih.gov who.int.
Comparaison géographique des taux de cancers
L’incidence du cancer varie considérablement selon les régions du monde et les pays, en raison de différences démographiques, environnementales et socio-économiques. De manière générale, les pays à revenu élevé présentent les taux de cancer les plus élevés, tandis que les pays à plus faible développement ont des taux moindres – mais souvent une mortalité plus élevée relativement au nombre de cas, en raison d’un accès limité au diagnostic et aux traitements.
En 2020, l’âge moyen de la population et certains facteurs de mode de vie font que l’incidence (taux de nouveaux cas par habitant, ajusté sur l’âge) est 2 à 3 fois plus élevée dans les pays développés que dans les pays en développement pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Les régions du monde affichant les taux d’incidence de cancer les plus élevés sont l’Amérique du Nord, l’Europe (notamment de l’Ouest et du Nord), l’Océanie (Australie/Nouvelle-Zélande) et certaines parties de l’Asie de l’Est. À l’inverse, les taux les plus bas sont observés en Afrique et dans certaines régions d’Asie du Sud acsjournals.onlinelibrary.wiley.com blog.dana-farber.org. Par exemple, l’Australie est l’un des pays ayant l’incidence la plus élevée (environ 452 cas de cancer pour 100 000 habitants en 2020), tandis que des pays d’Afrique de l’Ouest comme le Niger présentent des taux beaucoup plus faibles (de l’ordre de 78 pour 100 000 habitants) blog.dana-farber.org. Cette disparité s’explique en partie par la structure par âges (les pays africains ont des populations très jeunes, donc moins de cancers liés au vieillissement), mais aussi par la prévalence contrastée de certains risques (par exemple, le tabagisme et l’obésité sont très répandus en Occident, beaucoup moins en Afrique).
Il convient de noter que les pays les plus peuplés contribuent fortement au nombre total de cas de cancer dans le monde, même si leur taux d’incidence n’est pas nécessairement le plus élevé. La Chine par exemple, avec une incidence standardisée d’environ 202 pour 100 000, rapporte plus de 4,8 millions de nouveaux cas par an en raison de sa population immense wcrf.org. À l’inverse, des pays européens de plus petite taille comme la Belgique ou le Danemark affichent des taux d’incidence très élevés (souvent attribuables à un mode de vie à risque et à un dépistage intensif), mais leur poids dans les chiffres mondiaux est moindre.
Les profils de cancer diffèrent selon les régions du globe. Dans les pays à haut revenu, les cancers les plus fréquents sont ceux liés au mode de vie « occidental » : le cancer du sein, de la prostate, du poumon et le cancer colorectal figurent parmi les plus diagnostiqués en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Par exemple, en 2020 le cancer du sein féminin est devenu le cancer le plus diagnostiqué dans le monde (11,7 % de tous les nouveaux cas), dépassant le cancer du poumon (11,4 % des cas) pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Ces cancers prédominants reflètent souvent des facteurs de risque tels que le tabagisme (poumon), l’alimentation riche et la sédentarité (colorectal), ou des facteurs hormonaux et reproductifs (sein, prostate), typiques des sociétés industrialisées. En revanche, dans les pays à plus faible revenu, on observe une proportion plus importante de cancers d’origine infectieuse ou liés à de moindres ressources en santé. Par exemple, le cancer du col de l’utérus (lié au papillomavirus HPV) et le cancer du foie (souvent consécutif aux hépatites B ou C) figurent parmi les cancers les plus courants en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est who.int. De même, le cancer de l’estomac, associé à l’infection par H. pylori et à la conservation traditionnelle des aliments salés, reste fréquent dans certaines régions d’Asie de l’Est (Japon, Corée) même s’il est en déclin. À l’inverse, ces cancers infectieux sont beaucoup plus rares en Europe/Amérique du Nord grâce aux campagnes de vaccination (contre l’HPV ou l’hépatite B), au dépistage (frottis du col utérin) et à l’amélioration de l’hygiène de vie.
Les différences géographiques s’expliquent aussi par les politiques de santé publique et l’accès au dépistage. Un dépistage systématique peut à la fois augmenter les chiffres d’incidence (en détectant des cas latents) et réduire la mortalité (en traitant plus précocement). Par exemple, les pays nordiques et l’Europe de l’Ouest ont longtemps eu des taux enregistrés de cancer du sein plus élevés que l’Asie ou l’Afrique, en partie parce qu’ils disposent de programmes de mammographie qui identifient de nombreux cancers (y compris des tumeurs précoces) qui resteraient non diagnostiqués ailleurs. De même, l’incidence du cancer de la prostate est très élevée en Amérique du Nord et en Europe occidentale, non pas parce que les hommes y auraient un risque biologique supérieur, mais parce que le dépistage par dosage de PSA y est largement pratiqué, révélant beaucoup de cancers (y compris des formes indolentes) news.cancerresearchuk.org. À l’inverse, certains pays en développement ont une sous-détection : de nombreux cas de cancer ne sont pas diagnostiqués du tout (faute d’accès aux soins), ce qui conduit à sous-estimer l’incidence réelle. Ainsi, l’écart de mortalité entre pays riches et pays pauvres est moins important que l’écart d’incidence. L’IARC note que l’incidence globale des cancers est 2 à 3 fois plus élevée dans les pays « très développés » que dans les pays en développement, alors que la mortalité par cancer n’est en moyenne que 1,5 fois plus élevée dans ces pays riches par rapport aux pays pauvres pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. En effet, dans les pays à revenu faible, un plus grand nombre de cas ne sont découverts qu’à un stade avancé et ne peuvent pas être soignés, entraînant un taux de décès élevé parmi les cas.
En résumé, la cartographie mondiale du cancer présente un gradient Nord-Sud et Est-Ouest marqué : les sociétés industrialisées, vieillissantes et urbanisées enregistrent davantage de cancers (en particulier ceux liés au tabac, à l’alcool, à l’alimentation et aux facteurs reproductifs), tandis que les pays à population jeune et en développement font encore face à une double charge, avec la persistance de cancers d’origine infectieuse mais une augmentation des cancers « modernes » à mesure que l’espérance de vie et l’adoption des modes de vie occidentaux augmentent ncbi.nlm.nih.gov. Cette transition est en cours dans de nombreux pays émergents, où l’on voit diminuer la fréquence de cancers comme celui du col de l’utérus (grâce à la vaccination et au dépistage) ou du foie, mais augmenter les cancers du poumon, du sein ou du côlon avec l’urbanisation et les changements de modes de vie ncbi.nlm.nih.gov. Les projections pour 2040 prévoient que c’est dans les pays à IDH faible ou intermédiaire que l’augmentation relative du nombre de cancers sera la plus forte, du fait de la croissance démographique et de l’amélioration de la longévité ncbi.nlm.nih.gov.
Principales causes de l’augmentation des cancers
Plusieurs facteurs majeurs expliquent l’augmentation observée du taux de cancers à long terme. Ces causes sont à la fois démographiques, environnementales et comportementales :
- Vieillissement de la population : Le facteur le plus déterminant est l’allongement de la vie humaine. Le cancer est avant tout une maladie liée à l’âge : la plupart des cancers surviennent après 60 ans. Or, l’espérance de vie mondiale est passée d’environ 30 ans au XIX^e siècle à plus de 72 ans aujourd’hui. La probabilité de développer un cancer augmente exponentiellement avec l’âge, car les erreurs génétiques s’accumulent dans nos cellules au fil du temps news.cancerresearchuk.org. Ainsi, plus de trois quarts des cancers surviennent chez des personnes de plus de 60 ans dans les pays développés news.cancerresearchuk.org. L’amélioration générale des conditions de vie (réduction de la mortalité infantile et des maladies infectieuses) fait que beaucoup plus d’individus atteignent ces âges avancés qu’autrefois. Ce vieillissement démographique explique une large part (environ deux tiers) de l’augmentation du risque global de cancer sur les dernières décennies news.cancerresearchuk.org. Autrement dit, si la structure d’âge de la population était restée la même qu’en 1950, on n’observerait qu’une hausse beaucoup plus modérée du taux de cancers.
- Croissance de la population : Lié au point précédent, le simple fait qu’il y ait davantage d’êtres humains sur Terre implique un nombre absolu de cas de cancers plus élevé. La population mondiale a été multipliée par plus de quatre entre 1900 et 2020, entraînant mécaniquement une multiplication des cas de cancer, même à incidence égale. Cette croissance n’influe pas le taux (pour 100 000 personnes) directement, mais contribue à la perception d’une « épidémie » de cancer en termes de nombre total de malades.
- Tabagisme (fumée de tabac) : Le tabac est le facteur de risque de cancer le plus important et le plus largement répandu au XX^e siècle. Il est responsable d’une large part de l’augmentation des cancers, en particulier du cancer du poumon qui était une maladie presque inexistante en 1900 et qui est devenu dans la deuxième moitié du XX^e siècle l’un des cancers les plus courants et les plus mortels. Le tabagisme cause aussi de nombreux cancers d’autres organes (bouche, larynx, œsophage, vessie, pancréas, etc.). Selon l’OMS, environ un tiers de tous les décès par cancer dans le monde sont dus à cinq principaux facteurs évitables, dont le tabagisme arrive en tête who.int. Dans les pays occidentaux, la « peste » du tabac a provoqué une explosion des cancers du poumon entre les années 1940 et 1980, surtout chez les hommes – jusqu’à 80 % des décès par cancer du poumon étaient attribuables à la cigarette cancer.org. Par exemple, aux États-Unis, le taux de mortalité par cancer du poumon chez l’homme a été multiplié par plus de 10 du début du XX^e siècle aux années 1990, avant de redescendre lorsque les générations ayant massivement fumé ont diminué medecinesciences.org. Chez la femme, le pic est survenu plus tard (années 1990-2000) en raison d’une adoption plus tardive du tabagisme dans la population féminine news.cancerresearchuk.org. Le tabac à lui seul est estimé être responsable d’environ 20 % des décès par cancer dans le monde aujourd’hui who.int. La diffusion mondiale du tabagisme (y compris dans les pays en développement, où l’industrie du tabac s’est implantée au XX^e siècle) a donc grandement contribué à l’augmentation mondiale des cancers.
- Changements d’alimentation et obésité : L’industrialisation s’est accompagnée de profondes modifications des habitudes alimentaires. La disponibilité accrue de nourriture bon marché, riche en calories, en graisses et en sucres, ainsi que la sédentarité croissante, ont conduit à une hausse du surpoids et de l’obésité dans de nombreuses populations. Or, le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque établis pour au moins 13 types de cancers (dont le cancer du côlon, du sein après la ménopause, de l’utérus, du rein, du foie, du pancréas…) news.cancerresearchuk.org. Par exemple, l’augmentation de l’obésité a été corrélée à une hausse notable des cancers de l’utérus et du rein dans les pays occidentaux ces dernières décennies. Une alimentation déséquilibrée, pauvre en fruits et légumes et riche en viandes rouges ou transformées, augmente également le risque de cancers digestifs (colorectal en particulier) who.int. À l’échelle mondiale, la transition nutritionnelle (passage d’une alimentation traditionnelle à une alimentation de type « occidental » plus riche) explique une part de plus en plus grande des cancers dans les pays émergents. L’OMS attribue une fraction non négligeable des décès par cancer à une consommation insuffisante de fruits et légumes who.int. L’obésité et le manque d’activité physique compteraient pour environ 5 à 10 % des cancers dans les pays occidentaux, et ces chiffres sont en hausse là où la « malbouffe » progresse. En France, par exemple, la hausse des cancers du foie et de l’endomètre a été en partie liée à l’augmentation du syndrome métabolique (obésité, diabète) dans la population reseau-environnement-sante.fr.
- Consommation d’alcool : La consommation d’alcool est un cancérigène bien établi, contribuant aux cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, du foie, du sein et du côlon. Dans de nombreux pays, la consommation d’alcool a augmenté au XX^e siècle (en particulier après la Seconde Guerre mondiale en Europe). Même si elle tend à diminuer légèrement dans certains pays occidentaux depuis les années 2000, l’alcool demeure un facteur causal important. En France par exemple, l’alcool est après le tabac le deuxième facteur de risque de cancer évitable, impliqué dans environ 8 % des nouveaux cas de cancers annuellement (en particulier des voies aérodigestives supérieures et du foie) reseau-environnement-sante.fr. L’OMS inclut l’alcool parmi les cinq facteurs de risque comportementaux majeurs expliquant un tiers des décès par cancer who.int. L’alcool et le tabac agissant en synergie (leur combinaison multiplie les risques de cancer ORL), les pays à forte consommation des deux (Europe de l’Est, France, etc.) ont historiquement eu des incidences élevées de ces cancers.
- Expositions professionnelles et polluants environnementaux : L’essor industriel a multiplié les agents cancérogènes environnementaux. Dès la fin du XIX^e siècle, on a découvert que certaines expositions professionnelles causaient des cancers spécifiques (outre les ramoneurs de Pott, on peut citer les ouvriers des usines d’aniline développant des cancers de la vessie, les mineurs exposés au radon pour le cancer du poumon, etc.). Le XX^e siècle a vu l’utilisation massive de substances chimiques (amiante, hydrocarbures polycycliques, pesticides, solvants organiques, etc.), dont certaines se sont révélées cancérogènes des années ou décennies plus tard. Par exemple, l’exposition à l’amiante (fibres autrefois largement utilisées dans le bâtiment et l’industrie) a provoqué une épidémie de mésothéliomes (cancers de la plèvre) et de cancers du poumon, atteignant un pic vers la fin du XX^e siècle dans les pays qui l’avaient beaucoup employée. De même, la pollution de l’air est désormais reconnue comme un facteur contribuant au cancer du poumon : en 2013, le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC/IARC) a classé la pollution atmosphérique globale comme cancérogène certain. L’OMS souligne que la pollution de l’air ambiant, en particulier les particules fines, est un important facteur de risque du cancer pulmonaire who.int. Les zones fortement industrialisées ou urbanisées avec une mauvaise qualité de l’air affichent ainsi des taux plus élevés de cancer du poumon (on pense à certaines régions de Chine, d’Inde ou même aux grandes métropoles). Les produits chimiques dans l’environnement (pesticides, perturbateurs endocriniens, etc.) suscitent également des inquiétudes quant à leur rôle potentiel dans l’augmentation de certains cancers (comme les cancers hormonodépendants ou les leucémies), bien que leur impact exact soit difficile à quantifier et souvent débattu. Néanmoins, l’exposition globale de la population à des agents potentiellement cancérogènes (polluants industriels, rejets toxiques, radiations ionisantes accidentelles, etc.) a globalement augmenté avec l’industrialisation, ce qui peut contribuer sur le long terme à l’augmentation de l’incidence de certains cancers. Par exemple, le nucléaire et les essais atomiques ont accru l’exposition aux rayonnements ionisants : on a constaté un excès de cancers de la thyroïde après l’accident de Tchernobyl en 1986 dans les populations voisines, et les survivants des bombardements atomiques de 1945 au Japon ont présenté davantage de cancers sur leur vie entière. Bien que ces événements ne concernent qu’une part limitée de la population mondiale, ils illustrent l’impact possible de nouvelles expositions environnementales sur le fardeau du cancer.
- Changements dans les modes de vie (sédentarité, UV, reproduction) : D’autres aspects des modes de vie modernes ont influencé le risque de cancer. La sédentarité (réduction de l’activité physique quotidienne) est de plus en plus répandue avec l’urbanisation et la mécanisation du travail. Or, l’activité physique régulière a un effet protecteur démontré contre plusieurs cancers (colon, sein, endomètre). L’inactivité physique, souvent liée à l’obésité, contribue donc indirectement à l’augmentation de ces cancers. Par ailleurs, les habitudes culturelles ont évolué : l’exposition aux rayons ultraviolets par le bronzage volontaire s’est banalisée au XX^e siècle (vacances balnéaires de masse, salons de bronzage artificiel), entraînant une hausse des mélanomes et autres cancers de la peau dans les populations caucasiennes news.cancerresearchuk.org news.cancerresearchuk.org. En ce qui concerne les facteurs reproductifs, les sociétés modernes voient les femmes avoir moins d’enfants et plus tardivement qu’auparavant, avec une diminution de la durée d’allaitement. Or, chaque grossesse et chaque période d’allaitement réduisent légèrement le risque de cancer du sein et de l’ovaire. L’abaissement de la fécondité et le recul de l’âge maternel ont donc, modestement mais de façon populationnelle, augmenté le risque moyen de cancer du sein sur la vie des femmes news.cancerresearchuk.org. De même, la diffusion de certains traitements hormonaux (contraception orale, traitements hormonaux substitutifs de la ménopause) a pu avoir un effet limité mais réel sur l’incidence de cancers hormonodépendants (sein, endomètre), bien que ces effets soient complexes et équilibrés par des bénéfices dans d’autres domaines de la santé. En résumé, nombre de comportements liés à la vie moderne (alimentation riche, faible exercice, expositions volontaires au soleil, usage de substances comme tabac/alcool) se sont traduits par une augmentation du risque de cancer par rapport aux modes de vie traditionnels.
- Facteurs infectieux et transition sanitaire : Une part importante des cancers dans le monde est liée à des infections chroniques. Historiquement, dans les pays en développement, ces cancers infectieux (cancer du foie lié au virus de l’hépatite, cancer du col de l’utérus lié à l’HPV, cancer de l’estomac lié à H. pylori, sarcome de Kaposi lié au VIH, etc.) représentaient une fraction majeure des cas. Avec le développement économique, ces cancers ont tendance à diminuer (vaccination contre l’hépatite B et le HPV, antibiotiques contre H. pylori, traitements antiviraux contre le VIH). Par exemple, le cancer du col utérin a fortement reculé en Europe depuis les années 1970 grâce au frottis de dépistage et recule désormais dans le monde grâce à la vaccination HPV. Toutefois, la transition épidémiologique fait que la baisse de ces cancers d’origine infectieuse est contrebalancée par la hausse des cancers liés aux modes de vie industrialisés ncbi.nlm.nih.gov. Par ailleurs, certains phénomènes comme l’épidémie de VIH/SIDA dans les années 1980-90 ont temporairement augmenté l’incidence de cancers opportunistes (Kaposi, lymphomes) dans les régions touchées, même si ce n’est pas un moteur global à long terme. Au total, l’évolution de la médecine infectieuse (antibiotiques, vaccins) a fait reculer certains cancers, mais ce gain a été annulé par l’émergence de nouveaux facteurs de risque, maintenant voire augmentant l’incidence globale.
En synthèse, la hausse des cancers résulte d’un ensemble de causes multifactorielles. Les analyses de santé publique estiment qu’environ 30 à 50 % des cancers pourraient être évités si l’on supprimait les expositions à ces facteurs de risque connus (tabac, alcool, obésité, infections, UV, etc.) who.int who.int. Néanmoins, même en absence de tout risque évitable, le fait que la population vieillit suffirait à garder une incidence élevée du cancer. L’augmentation observée sur le siècle dernier est donc en grande partie le « prix » à payer de nos succès contre d’autres maladies et de nos styles de vie modernes.
Impact du progrès médical et du dépistage
Les progrès de la médecine au cours du XX^e siècle ont eu un double effet sur les statistiques du cancer : d’une part, ils ont permis de mieux détecter et enregistrer les cancers (ce qui tend à augmenter les taux d’incidence observés), et d’autre part, ils ont amélioré la prise en charge et la survie des patients (ce qui réduit la mortalité pour un taux d’incidence donné).
Amélioration du diagnostic et des registres : Au début du XX^e siècle, de nombreux cancers n’étaient pas diagnostiqués comme tels – faute d’imagerie médicale, de biopsie ou même de formation adéquate, beaucoup de personnes mouraient de maladies non identifiées (par exemple, on parlait de consomption, de « tumeurs » sans précision, ou on imputait la mort à une cause immédiate sans remonter au cancer sous-jacent). Avec les progrès de l’anatomopathologie (microscope) et la généralisation des autopsies au XX^e siècle, on a commencé à mieux reconnaître les cancers internes. Puis l’essor de l’imagerie médicale (radiographie, échographie, scanner, IRM, etc.) a permis dès la fin du XX^e siècle de détecter des tumeurs de plus en plus petites chez des patients vivants. Cette amélioration du diagnostic a contribué à une augmentation artificielle des taux d’incidence dans les statistiques : de nombreux cancers qui seraient passés inaperçus auparavant sont à présent comptabilisés. Un exemple frappant est celui du cancer de la thyroïde : avec l’échographie de la thyroïde largement utilisée dans certains pays à partir des années 1990, l’incidence de ce cancer a explosé (par exemple en Corée du Sud, multipliée par 15 en quelques années), car on découvrait des micro-cancers qui, dans le passé, n’auraient jamais été diagnostiqués de leur vivant. De même, le cancer de la prostate a vu son incidence bondir aux États-Unis et en Europe à la fin des années 1980 avec l’introduction du dosage sanguin de PSA : soudain, on détectait des milliers de cancers latents qui auparavant seraient restés ignorés news.cancerresearchuk.org. Une bonne partie de cette hausse n’était pas due à une cause environnementale, mais bien à un dépistage plus intensif. Les registres du cancer, qui collectent systématiquement les cas, se sont multipliés après les années 1950 (le premier registre de population a été créé en 1942 en Norvège). À partir des années 1960-70, la plupart des pays occidentaux ont mis en place des registres régionaux ou nationaux du cancer, améliorant la qualité des données épidémiologiques. Ainsi, il est probable qu’une part de l’augmentation du « taux de cancers » observée dans les données vient simplement du fait qu’on mesure mieux le phénomène qu’avant. Historiquement, de nombreux cas n’étaient pas diagnostiqués : par exemple, on attribuait la mort d’une personne âgée à des « causes naturelles » ou à une défaillance d’organe sans savoir qu’il s’agissait d’un cancer métastatique. Aujourd’hui, grâce aux scanners et aux examens, la plupart des cancers mortels sont identifiés comme tels sur les certificats de décès. Le recul de la rubrique des causes de décès « indéterminées » s’est accompagné de la hausse correspondante des diagnostics de cancer ourworldindata.org. Une étude a d’ailleurs montré que si l’on applique des méthodes modernes de détection à des restes humains anciens, on détecte bien plus de cancers que ce qui était visible initialement nationalgeographic.fr – illustrant ainsi le rôle de la technologie diagnostique.
Progrès du dépistage organisé : Au-delà du diagnostic individuel, la mise en œuvre de programmes de dépistage de masse pour certains cancers a eu un impact notable. Le dépistage vise à détecter les cancers (ou lésions précancéreuses) avant l’apparition de symptômes, afin d’intervenir plus tôt. Les premiers programmes ont concerné le cancer du col de l’utérus avec le test de Papanicolaou (frottis cervical) inventé dans les années 1940 et diffusé à grande échelle dans les pays développés à partir des années 1960. Ce dépistage a permis de réduire drastiquement l’incidence du cancer du col (en traitant des lésions précancéreuses avant qu’elles n’évoluent) dans les pays qui l’ont mis en place : par exemple, l’incidence du cancer du col a chuté de plus de 70 % en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest entre 1960 et 1990. Cependant, à court terme, l’enregistrement de ces lésions et micro-cancers détectés peut donner l’impression d’une augmentation du nombre de cas. De même, le dépistage du cancer du sein par mammographie, déployé à partir des années 1980-90, a conduit à une hausse du nombre de cancers du sein diagnostiqués (beaucoup de petites tumeurs étant découvertes plus tôt qu’elles ne l’auraient été sans dépistage) news.cancerresearchuk.org. Une partie de cette hausse correspond à un avantage (découvrir plus tôt des cancers qui de toute façon se seraient déclarés), mais une autre partie représente du sur-diagnostic : des tumeurs indolentes qui n’auraient peut-être jamais évolué de manière dangereuse sont malgré tout détectées et comptabilisées comme « cancer ». Les estimations suggèrent qu’une proportion non négligeable de cancers du sein ou de la prostate dépistés relèvent de ce sur-diagnostic. Ainsi, paradoxalement, plus on dépiste, plus le taux d’incidence enregistré peut augmenter, sans que cela reflète un véritable changement des facteurs de risque dans la population. Il faut donc interpréter les tendances d’incidence en tenant compte des pratiques de dépistage. Par exemple, en France, l’augmentation de plus de 100 % de l’incidence du cancer de la prostate chez l’homme entre 1990 et 2005 a été largement attribuée à l’introduction du dosage PSA et à l’« amélioration des méthodes diagnostiques » pour ce cancer, plutôt qu’à une cause environnementale nouvelle reseau-environnement-sante.fr. De même, une part de l’augmentation des cancers du sein féminins observée sur la fin du XX^e siècle était liée à la généralisation de la mammographie de dépistage et à un effet de rattrapage (diagnostic anticipé) news.cancerresearchuk.org.
Impact sur la mortalité et survie : Les progrès médicaux ont surtout eu un impact majeur sur le pronostic des cancers. Les traitements (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, puis thérapies ciblées et immunothérapie récemment) se sont améliorés, ce qui a permis de guérir ou de prolonger la vie de nombreux patients. Dans les pays développés, la survie à 5 ans pour l’ensemble des cancers est passée d’environ 30 % dans les années 1960 à près de 70 % de nos jours. Par exemple, au Royaume-Uni la survie moyenne à 10 ans pour tous cancers confondus est passée de 24 % dans les années 1970 à 50 % aujourd’hui news.cancerresearchuk.org – un progrès remarquable. Cette amélioration de la survie ne réduit pas le taux d’incidence (puisqu’elle n’empêche pas de nouveaux cas de survenir), mais réduit la mortalité et augmente le nombre de personnes vivant avec un diagnostic de cancer (prévalence). Autre progrès : certains dépistages permettent de prévenir le cancer en traitant des lésions précancéreuses (c’est le cas du dépistage du col de l’utérus, qui élimine des lésions de dysplasie avant qu’elles ne dégénèrent, ou du dépistage du cancer colorectal par coloscopie, qui permet de retirer des polypes adénomateux avant qu’ils n’évoluent en cancer invasif). Ces interventions ont pu faire baisser l’incidence de ces cancers dans les pays où elles sont pratiquées à grande échelle. Par exemple, aux États-Unis, on observe depuis 2000 une baisse continue de l’incidence du cancer colorectal attribuée en partie à la détection et l’ablation préventive des polypes lors des coloscopies de dépistage news.cancerresearchuk.org.
En somme, le progrès médical a eu un effet ambivalent sur les chiffres : il a contribué à augmenter les taux de cancers observés (en révélant les cas cachés et en allongeant la vie des gens jusqu’à des âges à risque), tout en réduisant la létalité de ces cancers. C’est pourquoi, dans certains pays occidentaux, on voit la mortalité par cancer baisser alors même que l’incidence brute augmente. Par exemple, aux États-Unis entre 1990 et 2015, le taux de mortalité par cancer a diminué d’environ 26 %, alors que le nombre de nouveaux cas annuels continuait d’augmenter du fait de la démographie medecinesciences.org. Le progrès médical a donc transformé le cancer en une maladie davantage diagnostiquée mais aussi mieux soignée qu’autrefois.
Synthèse finale
Bilan historique et mondial : L’évolution des taux de cancers à travers les époques reflète les transformations de nos sociétés. Autrefois rarissimes ou méconnus, les cancers sont devenus avec la modernité un enjeu sanitaire central partout dans le monde. Cette augmentation doit cependant être nuancée : elle tient largement à l’augmentation du nombre de personnes âgées (le cancer étant principalement une maladie de la seconde moitié de la vie) et à l’amélioration du dépistage. Si l’on corrige des effets démographiques, on n’observe pas d’« explosion » incontrôlée du risque de cancer, mais plutôt une transition progressive – le cancer prenant la place des maladies infectieuses comme cause dominante de décès à mesure que l’humanité gagne en longévité ncbi.nlm.nih.gov pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Néanmoins, il serait erroné de penser qu’aucun facteur n’a aggravé le risque intrinsèque : en réalité, de nouvelles causes sont apparues et ont fait grimper l’incidence de certains cancers plus vite que le seul vieillissement ne l’aurait fait. Le XX^e siècle a vu l’essor du tabagisme, de la pollution industrielle, de changements alimentaires et comportementaux qui ont tous contribué à augmenter le risque de cancer dans la population. Par ailleurs, nombre de ces facteurs ont diffusé mondialement, entraînant une hausse des cancers même dans des régions auparavant préservées.
Principales causes de l’augmentation observée : On peut résumer les causes principales de l’augmentation des cancers comme suit : (1) le vieillissement et la croissance des populations (plus de personnes atteignant l’âge de risque) ; (2) l’adoption de comportements à risque (tabac, alcool, mauvaise alimentation, sédentarité, expositions solaires excessives) au cours de l’industrialisation et de l’urbanisation ; (3) l’exposition à de nouveaux agents cancérogènes liés à l’activité humaine (produits chimiques, pollution de l’air, etc.) ; (4) la persistance de certains facteurs infectieux dans une partie du monde (hépatites, papillomavirus, etc.) combinée à la transition sanitaire inégale ; (5) l’amélioration du dépistage et du diagnostic, qui gonfle les statistiques d’incidence en révélant des cas jadis ignorés. Parmi ces facteurs, ceux liés au mode de vie (tabac en particulier) et à l’environnement occupent une place de choix – les connaissances scientifiques actuelles suggèrent que la majorité des cancers s’expliquent par des causes externes (expositions, comportements) plus que par des causes purement génétiques ou aléatoires reseau-environnement-sante.fr. En France, par exemple, Santé Publique France estime que plus de 40 % des nouveaux cas de cancers annuels sont attribuables à des facteurs de risque évitables liés à l’environnement ou au mode de vie (tabagisme ~20%, alimentation déséquilibrée ~15%, alcool ~8%, surpoids/inactivité ~5%, infections ~4% etc.) reseau-environnement-sante.fr. Il en ressort que l’augmentation des cancers n’est pas une fatalité inexpliquée : elle a des causes identifiables, contre lesquelles on peut agir.
Perspectives : La compréhension de ces causes a d’ailleurs conduit à de nombreux efforts de prévention au cours des dernières décennies. Les politiques antitabac (hausse des taxes, interdiction de fumer dans les lieux publics, avertissements sanitaires) ont commencé à porter leurs fruits en réduisant le tabagisme dans plusieurs pays, ce qui se traduit déjà par la baisse des cancers du poumon chez les hommes dans ces pays medecinesciences.org. De même, la promotion d’une alimentation saine et de l’activité physique vise à freiner l’épidémie d’obésité et, à terme, à stabiliser voire réduire l’incidence des cancers associés. Les programmes de vaccination (contre le HPV et l’hépatite B) laissent espérer une forte diminution des cancers du col de l’utérus et du foie dans le futur. Ainsi, si le fardeau du cancer continue de croître en chiffres absolus du fait de la population vieillissante, on dispose aujourd’hui de leviers d’action pour infléchir la tendance. L’OMS estime qu’environ un tiers des cancers pourraient être évités par des mesures de santé publique appropriées (lutte contre le tabac et l’alcool, amélioration de la nutrition, vaccination, réduction de la pollution, etc.) who.int. Un autre tiers pourrait être guéri s’il est dépisté tôt et traité efficacement who.int. Les décennies à venir verront donc un accent mis sur la prévention primaire (réduction des expositions nocives) et la prévention secondaire (dépistage précoce), en plus des progrès thérapeutiques, pour contenir l’augmentation des cancers.
En conclusion, l’augmentation historique des taux de cancers est un phénomène complexe, résultant en grande partie des succès de la modernité (vie plus longue, meilleure détection) tout en étant alimenté par certains revers de cette modernité (polluants, modes de vie). Aujourd’hui, le cancer s’inscrit dans une dynamique de transition épidémiologique mondiale : il tend à toucher de plus en plus de personnes, notamment dans les pays en développement où l’incidence reste en deçà de celle des pays riches mais augmente rapidement. Comprendre les causes de cette augmentation permet de mettre en place des stratégies pour y faire face. Les tendances récentes montrent quelques signaux encourageants (baisse de certains cancers grâce à la prévention), mais le défi demeure immense compte tenu du vieillissement global de la population. La lutte contre le cancer doit donc combiner les approches : action sur les causes (réduction du tabagisme, amélioration de l’environnement), détection précoce et progrès des traitements. C’est à ce prix que l’on pourra espérer voir, dans la seconde moitié du XXI^e siècle, une stabilisation puis une diminution des taux de cancers à l’échelle mondiale, faisant mentir les projections actuelles alarmantes. Les enseignements de l’histoire – qui nous montrent à la fois l’impact des facteurs de risque et l’importance des avancées médicales – guideront ces efforts pour maîtriser enfin l’« épidémie » de cancer, sans cesse alimentée mais de mieux en mieux comprise.
Sources : Publications scientifiques et rapports d’agences internationales (OMS, CIRC/IARC, Cancer Research UK, American Cancer Society), données épidémiologiques historiques et contemporaines who.int pubmed.ncbi.nlm.nih.gov who.int ncbi.nlm.nih.gov reseau-environnement-sante.fr, revues de littérature sur l’histoire du cancer pmc.ncbi.nlm.nih.gov medecinesciences.org et analyses des facteurs de risque news.cancerresearchuk.org news.cancerresearchuk.org. Les chiffres et affirmations clés sont référencés tout au long du texte.
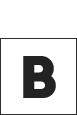



Sorry, the comment form is closed at this time.